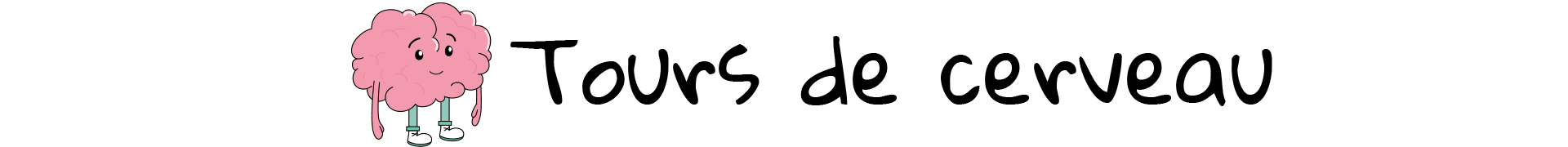Qu’est-ce que c’est qu’une croyance ?
La croyance c’est d’attacher une valeur de vérité à un fait ou un énoncé. C’est un état mental qui se décline en plusieurs degrés qui vont de la simple opinion à la science en passant par la foi.
La croyance est le fait de croire, c’est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réelle, d’être persuadé ou intimement convaincu qu’elle est vraie ou qu’elle existe.
La croyance est une façon de penser qui permet d’affirmer, sans esprit critique, des vérités ou l’existence de choses ou d’êtres sans avoir à en fournir la preuve et indépendamment des faits pouvant infirmer cette croyance. Elle s’oppose au savoir rationnel et à la certitude objective. Si l’objet de la croyance n’est pas accessible à l’expérience ou analysable de manière scientifique (par exemple l’existence de Dieu ou de l’au-delà), il n’est pas possible de prouver que la croyance est fausse. On parle alors de croyances non réfutables.
Un esprit critique doit être averti des biais cognitifs les plus courants et doit pouvoir faire la distinction entre savoir, croyances et opinion. Le croyant ou récepteur du message est animé par une logique limitée dans le temps, dans l’espace, culturellement et cognitivement. Ces limites font qu’on ne peut devenir des êtres de connaissances car on ne dispose pas de toutes les informations et ou ces dernières sont déformées.
1- Limites dimensionnelles
Rien n’est mieux qu’un exemple pour comprendre, un individu A ayant émigré vers un nouveau pays, il ne connaît rien de ses habitants, il y occupe 4 logements différents. Il déménage successivement car il souffre du bruit et du tapage nocturne que lui infligent ses voisins, il en conclut que les habitants de ce pays sont plus bruyants que ceux son pays d’origine. Celle-ci est une conclusion dimensionnellement limitée car l’idéal est d’être présent dans les appartements des deux pays au même temps pour pouvoir comparer donc l’information est biaisé par ces limites dimensionnelles.
Toute croyance s’opposant à la conclusion de l’individu A subira une taxation c’est-à-dire une difficulté à croire que par exemple les habitants de ce pays sont doux et calmes (vu son expérience) et inversement un produit cognitif qui confirme sa conclusion sera facilement plus consommé.
2- Limites culturelles
On n’abandonne pas facilement une croyance, on peut même aller à ne pas examiner l’argumentation du produit (idée) concurrent.
Dans les années 1935 le Dr Rendu propose de tester scientifiquement les allégations affirmant que la matière émet des ondes que les individus sont capables de percevoir (grâce aux pendules, sensibilité tactile …) la question posée est donc le radiesthésiste peut-il ressentir les radiations ? On a 2 produits cognitifs contradictoires (oui ou non).
A chacun des volontaires (117 dont 86 radiesthésistes) sera envoyé le plan d’un appartement comprenant 10 pièces dans lequel un sac de 50kg d’or est caché. Le participant aura 3 jours pour faire une proposition unique sinon les organisateurs changeront l’endroit du sac.
Résultat : 10% de réussite pour les radiesthésistes ce qui n’est ni moins ni plus que ce à quoi l’on pouvait s’attendre lors d’un tirage aléatoire (pareil pour le groupe des non-radiesthésistes) 🡺le produit « les radiesthésistes n’ont pas le pouvoir de détecter à distance les ondes émises » est rendu facilement consommable, grâce à cette expérience du fait que les résultats étaient proches entre radiesthésistes et les non radiesthésistes, même pour ceux qui embrassent les convictions inverses.
Mais un croyant n’abandonnera pas sa croyance après une seule expérience 🡺 Tout comme la limite dimensionnelle un système de représentation déjà mis en place bénéficiera de facilités de diffusion il peut même y avoir un effet de renforcement : une théorie, une croyance peut paraître originale alors que le terrain cognitif a largement été préparé par des éléments culturels.
3- Limites cognitives
Voici quelques exemples d’effets pour mieux cerner les limites cognitives:
Effet de la prémisse implicite : on entend dire qu’il est bon de manger du poisson juste avant un examen car il contient du phosphore ⇒ ceci est inutile car peu importe les quantités de poissons ingérées ( en l’occurrence le phosphore) cela ne changera pas la quantité de phosphore mobilisée par notre centre cérébrale.
Effet masque : la manipulation se repose sur cet effet, si on veut faire croire quelque chose à quelqu’un, on associe des mots c’est-à-dire utiliser un terme pour un autre sans que la personne “manipulée” se rende compte de cette substitution.
Exemple : on veut faire croire à un ami que la télépathie est bel et bien réel, dans une soirée on évoque quelques phénomènes surnaturels ( une sorte de préparation psychologique) et c’est ici qu’on lui parlera d’un télépathe qu’on connaît, le prénom du télépathe est associé à un objet, par exemple Eric = briquet donc dès que votre ami appellera et dira Allo Eric? La personne à l’autre bout du fil (télépathe) recevra le message codé et donc devinera facilement que l’objet s’agit d’un briquet.
Effet de l’induction hyperbolique : fondée sur une argumentation qui semble acceptable car c’est parti de prémisses suffisamment représentatives assez différentes qui nous incitent d’abord à généraliser puis à accepter la conclusion comme cas particulier, exemple :
- le cerveau du babouin contient de la sérotonine
- le cerveau de la sauterelle contient de la sérotonine
- donc le cerveau de la girafe contient de la sérotonine
Ceci semble convaincant car intuitivement la catégorie à laquelle on a rapporté les deux premiers exemples est “animaux” ⇒ le cerveau des animaux contient de la sérotonine.
Effet miroir : provoqué par tout énoncé et déclaration assez vague et général pour que chacun puisse s’y reconnaître. Cet effet prend place surtout dans toutes les croyances fondés sur des prédictions ( l’horoscope du quotidien)
Exemple produit par le physicien Henri Broch, il a demandé à ses étudiants volontaires de réciter par écrit leur dernier rêve. Ensuite il fallait donner le nom, prénom et la date de naissance le but étant de faire un descriptif de personnalités grâce à ces informations. Une semaine plus tard il revint avec les analyses de personnalités et il leur a demandé si ça leur correspondait et d’évaluer cette analyse en leur donnant 6 réponses possibles : excellent, bien, assez bien, assez mauvais, mauvais faux. En résultat, 69% estimèrent que ça correspondait excellemment, bien ou assez bien ⇒ Ce résultat est très intéressant sachant que ce descriptif a été rédigé à l’avance et est le même pour tout le monde.
Effet de transfert : cet effet suggère que certaines caractéristiques sont transmises d’un individu à un ensemble d’individus.
Exemple : dix personnes sont capables de soulever un poids 10 fois plus grand qu’une personne mais dix personnes auront-elles vraiment 10 fois plus d’idées qu’une personne ? ou dix personnes courent-elles dix fois plus vite qu’un individu isolé?
Vu tous ses exemples, on peut dire qu’un individu adhère à certains raisonnements en raison des limites de son appareil cognitif.