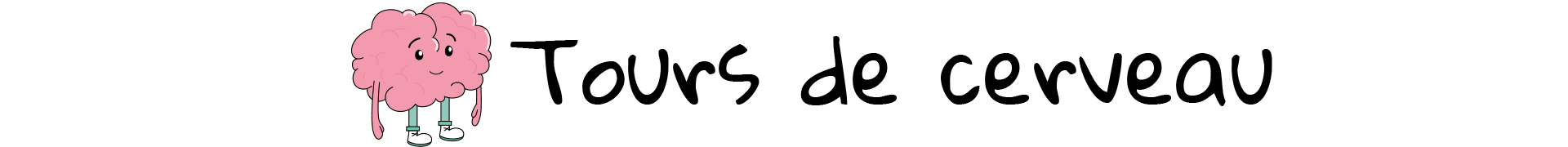Il existe 2 manières de parvenir à une découverte :
- Par hasard et sagacité, qui est définie par le concept de sérendipité.
- Ou, par une démarche rationnelle, en cherchant à comprendre les mécanismes.
Pour cela, nous avons besoin d’une manière de penser pour accumuler de la connaissance qui nous permettra d’émettre une conclusion. Ainsi avons-nous recours à une démarche inductive.
Induction
L’induction se définit à partir d’une série d’observations, on déduit une loi générale, un grand principe, sur une base probabiliste. (Particulier général)
Elle consiste à trouver une règle générale qui pourrait rendre compte de la conséquence, si l’observation empirique était vraie.
EX :
- Conséquence : Socrate est un homme
- Cas : Socrate est mortel
- Règle : Tous les hommes sont mortels
La démarche inductive par excellence est l’empirisme : à savoir un ensemble de théories philosophiques qui font de l’expérience sensible la source de toute connaissance et par extension, s’oppose au rationalisme.
C’est en se basant sur l’empirisme que beaucoup de médicaments ont été développés. Aujourd’hui, il est partiellement complété avec une démarche rationnelle, on parle de semi-empirisme.
Abduction & Sérendipité
Suite à l’acquisition des informations nécessaires par la démarche inductive, de nouvelles façons de penser plus concrètes se sont développées.
Tout d’abord : l’abduction, c’est le fait d’élaborer des hypothèses à partir de faits non attendus pour relier un cas général à une conséquence. (élaborer une observation)
Elle consiste à élaborer une observation empirique qui relie une règle générale à une conséquence.
EX :
- Conséquence : Socrate est mortel
- Règle : tous les hommes sont mortels
- Observation : Socrate est un homme
La démarche abductive par excellence est la Sérendipité, en effet ce terme a été décrit pour la 1ère fois par Sir Horace Walpole étant la faculté de découvrir, par hasard et sagacité des choses que l’on ne cherche pas. La notion de sagacité est très importante, car le hasard ne suffit pas, il faut être capable de se rendre compte de l’intérêt de ce que l’on a découvert afin de pouvoir l’exploiter.
La sérendipité existe sous 4 formes :
1 – Le fait de trouver par hasard, par chance ou par accident autre chose, et même parfois le contraire de ce que l’on cherchait, et de se rendre compte de son intérêt ou de son importance
Exemple : L’aspartame : James M. Schlatter (chimiste) cherchait à créer un antiulcéreux, il s’humecte les doigts pour tourner les pages de son cahier et se rend compte qu’ils ont un goût sucré. Il teste alors soigneusement la molécule, et découvre donc l’aspartame.
2 – Le fait de trouver quelque chose que l’on cherchait mais à la suite d’un accident plus ou moins malheureux ou d’une erreur, c’est à dire par un moyen imprévu, et de s’en rendre compte.
Ichiro Endo chercheure pour l’entreprise Canon, voulait trouver un nouveau procédé d’impression. Un jour, il met par accident en contact un fer à souder et une seringue remplie d’encre ; une bulle est formée faisant jaillir l’encre de la seringue. C’est ainsi que l’imprimante à jet d’encre était née.
3 – La faculté de trouver par accident, hasard ou par chance l’idée d’une innovation.
Exemple : Alors qu’il faisait une balade George de Mestral, ingénieur, remarqua qu’il était difficile d’enlever les fleurs de Bardanes des poils de son chien. Il décide donc d’observer les fleurs au microscope, et visualise des petits crochets. Il a alors l’idée d’un nouveau système de fermeture : le velcro.
4 – Le fait de trouver par hasard, par accident ou par chance une application imprévue à quelque chose, et de s’en rendre compte.
Exemple : De nombreux médicaments, comme par exemple le cisplatine, ou encore l’isoniazide.
Donc, en termes d’inférence logique, la sérendipité est lié au concept d’abduction. En effet l’abduction correspond à l’élaboration d’une observation empirique c’est-à-dire reliant une règle générale à une conséquence.
La règle + la conséquence = cas empirique
- Conséquence : Socrate est mortel.
- Règle : Or tous les Hommes sont mortels.
- Observation : Donc, Socrate est un homme.
Déduction
La deuxième se nomme la déduction : à partir d’une loi générale vraie on tire toutes les conséquences possibles. (Général particulier)
Elle consiste à tirer une conséquence à partir d’une règle générale et d’une observation empirique.
EX :
- Règle : tous les hommes sont mortels.
- Cas : Socrate est un homme
- Conséquence : Socrate est Mortel
La démarche déductive par excellence est le rationalisme : la production de la connaissance provient de la réflexion propre à partir de données scientifiques et des données que nous avons et non pas extraite de l’environnement. Cela abouti à l’établissement de mécanismes Le raisonnement déductif, par l’abstraction est l’outil de connaissance par excellence, la démarche rationnelle de production des idées.
Il est très aisé d’user de l’induction pour expliquer le monde, l’accumulation des expériences diminue le taux d’erreur de représentation que l’on a de celui-ci. Une base de nos connaissances personnelles est importante afin de permettre à une découverte hasardeuse d’être exploité. Cela donne lieu au à la pensé abductive. Ces informations sont complétées par la démarche déductive. Cependant on se doute que la véracité des informations encodés pour effectuer cette démarche va changer notre représentation. C’est ainsi qu’il est possible de se rendre compte de ses erreurs et de modifier sa perception des informations. Eh oui !! Comme les professeurs se tuent à le dire, l’erreur fait partie de l’apprentissage.
C’est donc la complémentarité entre induction, abduction et déduction qui amène en partie à notre savoir.